Je vous sens chaud patate sur les prépositions, j'en dégoupille une autre "au coiffeur/chez le coiffeur", saviez-vous que les deux variantes sont grammaticalement tout aussi justes ? 😇 mini 🧵
1/ "au coiffeur", "au dentiste" c'est la variante qui devrait logiquement plaire aux puristes, aux nostalgiques des formes anciennes, féru'es d'étymologie. On faisait la distinction, encore au 19e siècle, entre "aller chez quelqu'un" (domicile, étymologie "casa") et aller "à quelqu'un", bureau, office, travail. Dans toutes les éditions du Dico de l'Académie entre le 17e et le 19e on lisait : ⤵️
"Aller au roi, au ministre, à l’évêque, etc., S’adresser au roi, au ministre,à l’évêque, etc. Pour cela il vous faut aller au ministre. On a dit aussi, Aller au devin, Aller le consulter".
source ici l'édition de 1878 https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A7A0890
On aurait pu conserver cette nuance, et continuer à distinguer entre "aller au ministre, au docteur, au coiffeur" (au bureau, cabinet, salon, pour le travail) et "aller chez le ou la ministre, le ou la docteure, le coiffeur ou la coiffeuse" au domicile, quand on rend une visite privée comme "aller chez ses grands-parents".
Mais l'histoire de la préposition "chez" a bifurqué ⤵️
2/ Au 19e, et même début 20e, il y avait encore des artisans et professions libérales qui travaillaient chez eux ("chez le boucher = son domicile et sa boutique, idem médecin, avocat, notaire...). Après, le travail a changé et ces gens ont commencé à exercer leur métier dans des endroits autres que leur domicile.
C'est là que le sort de la préposition "chez" a basculé : extension de sens. On a oublié son étymologie et les profs / académiciens ont décidé qu'on devait garder les constructions "chez" même si ce n'était plus le domicile. Et au passage prohiber les constructions "au ministre, à l'évêque, au coiffeur".
Voilà l'origine d'une nouvelle règle ⤵️
Evidemment l'usage ancien ("chez = domicile / à = lieu de travail") a résisté, mais il s'est fait rétrograder en "populaire" et on a enseigné aux gens qu'il fallait utiliser la (nouvelle) préposition "chez" avec son sens élargi à chaque fois qu'on parlait d'une personne...
...ouvrant ainsi la porte à un sacré bazar (toujours en cours) avec les noms de marques (chez ou à Carrefour? chez ou à SFR?) que je vous laisse découvrir dans l'article que j'avais publié ya quelques années avec @laelia_ve : https://theconversation.com/aller-chez-le-coiffeur-mais-aller-aux-putes-ce-que-revele-lusage-des-prepositions-114557
Étonnamment (non :)) ce sont les mêmes, en général, qui 1/condamnent de tout leur poids les variantes "au coiffeur" défendant l'extension de sens de la préposition "chez" sans le savoir, au nom de toutes sortes de raisons qui parfois recrutent les rapports sexuels entre la vache et le taureau, et 2/ simultanément poussent des cris d'orfraie au sujet des extensions actuelles du sens de la préposition "sur".
Moi je pars sur 👍 l'option "décrivons, décryptons", comme souvent en matière de langue: tous ces usages sont intéressants à décrire et tous ont leur logique.
Ce serait sympa de tenter de les comprendre sans les hiérarchiser à tout bout de champ =fin=
@MarCandea Ma solution, c'est de toujours rester chez moi et de voir personne.
Tutut les rageux 😎😎😎
@MarCandea @laelia_ve Ça me fait repenser aux instructions récentes (pas si récentes en fait) du service com de l'Inria pour qu'on dise "à Inria", puisque c'est une marque.
@legendarybassoon @MarCandea @laelia_ve Dans le temps, INRIA c'était un sigle, mais apparemment "institut national" ça fait ringard, communiste ou je ne sais quoi, et puis "automatique" personne ne sait ce que c'est à moins d'être proche du domaine.
"Inria" ça fait comme "Vivendi" ou "Google", c'est un nom propre, une marque.
@MonniauxD @MarCandea @laelia_ve Le nom de mon laboratoire en thèse était un sigle que tout le monde a toujours écrit en majuscules (d'autant que c'est un prénom féminin pas forcément flatteur).
Un jour le service comm de mon université a écrit un article sur un truc qui me concernait et je devais relire. Elle avait écrit comme le prénom donc j'ai envoyé comme correction "attention le nom du labo s'écrit en majuscules".
@MonniauxD @MarCandea @laelia_ve
Elle m'a répondu "Non, les acronymes qui se prononcent sans s'épeler s'écrivent avec seulement la première lettre en majuscule".
@legendarybassoon @MonniauxD @laelia_ve comme l'OTAN, l'UNESCO ?
🤦♂️ 🤦♂️
@MarCandea "recrutent les rapports sexuels entre la vache et le taureau", j'ai pas compris ?
@pleursdejoie @MarCandea on mène la vache AU taureau mais chez le véto ;)
@urens @pleursdejoie exact. On m'a souvent rapporté la transmission de cette formule, mnémotechniques, qui tient lieu d'explication pour plein (plein plein plein) de gens en France en tout cas
@MarCandea De mémoire, Desproges disait que, pour bien parler, il fallait éviter de dire « je vais au coiffeur », et plutôt préférer dire « je vais au capilliculteur ».
- replies
- 0
- announces
- 1
- likes
- 2
@MarCandea alors j'ai une question.
Avoir goût à /avoir un goût de
J'ai subi de longues moqueries car je dis "ça a goût à fraise" au lieu de "ça a un goût de fraise". Est ce qu'il y a un débat là dessus ou pas du tout ?
*regard plein d'espoir*
@vieveca est-ce que ça peut être dû à un contact avec une autre langue, ou pas vraiment ?
Je ne connais pas la réponse, je peux booster?
@MarCandea tout dépend de ce qu'on appelle une autre langue 😅
Disons que c'est très courant dans les villages de la plaine côtière de l'Hérault et du Gard. En effet les patois locaux y sont restés vivaces jusqu'aux années 80-90
Oui bien sûr pour le repouet !
@vieveca ah ok, ça a l'air d'être tout simplement une variante régionale courante et admise, je trouve par exemple cette occurence dans un journal du club montpelliérain de scrabble de juin 1986:
https://www.montpellier-scrabble.org/download/MotsDeTete/MotsDeT%C3%AAte_013_1986_06.pdf
Il faudrait voir depuis quand elle est attestée et dans quels types de textes, mais il n'y a clairement aucune raison de moquerie. Le sens est très clair. Ya espoir😊
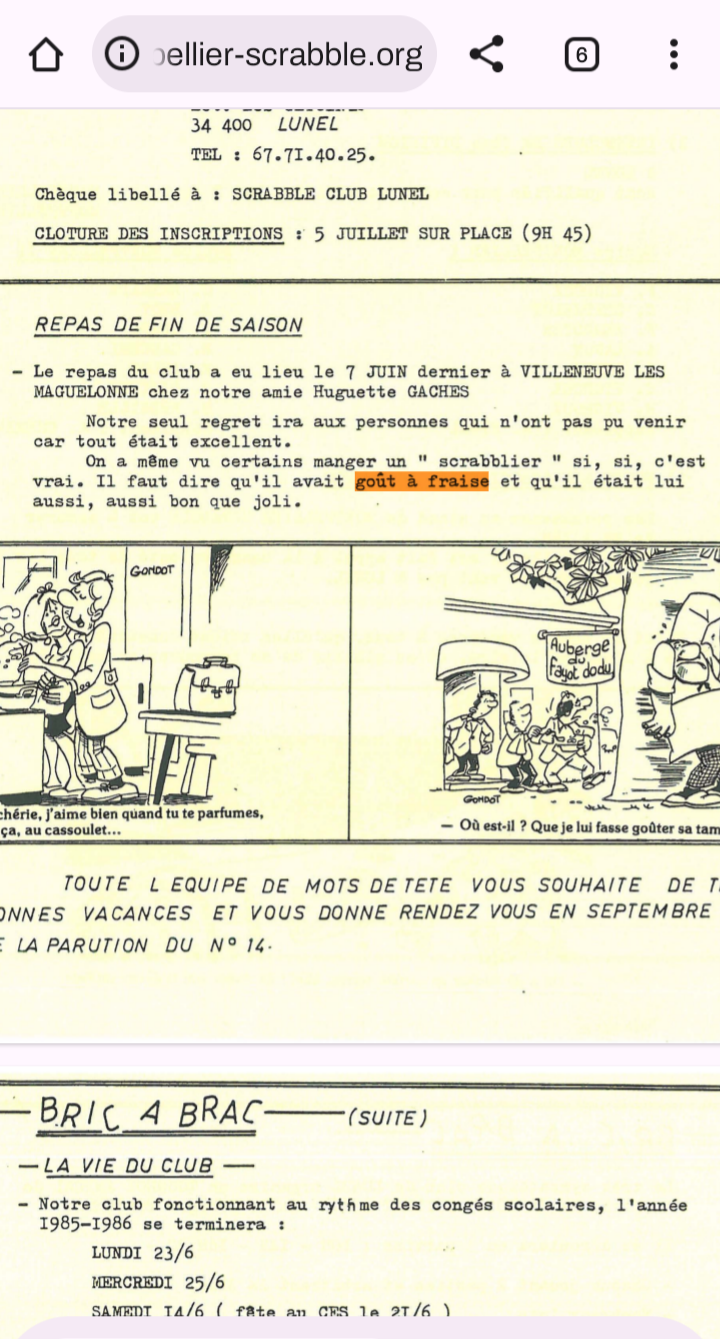
@vieveca @MarCandea
Vraie question : qu'est ce qui fait la différence entre patois, dialecte et langue ?
Je suppose qu'il doit exister un continuum plus ou moins irrégulier mais peut-on trouver des ruptures franches pour donner de vraies définitions pas trop arbitraires ?
@westphalchristian @vieveca Ya pas de différence linguistique opérationnelle entre langue, dialecte, patois; la différence décisive est politique et ça peut parfois changer quasiment du jour au lendemain.
Un bon résumé ici :
https://shs.cairn.info/revue-langage-et-societe-2021-HS1-page-189?lang=fr
___L’adage dit : « Une langue est un dialecte avec une armée et une marine » ou « un dialecte qui a réussi. » Attribuer ou non un nom à une langue est le privilège du pouvoir politique et d’une position de dominant, qui peut faire advenir un idiome ou lui nier toute existence___ etc, ce texte est une synthèse de quelques pages.
Dans le même dictionnaire encyclopédique ya aussi les entrées dialecte et patois.
@MarCandea @laelia_ve j'aime utiliser la formule un peu vieillie "aller au pain", mais je crois que c'est un autre sujet